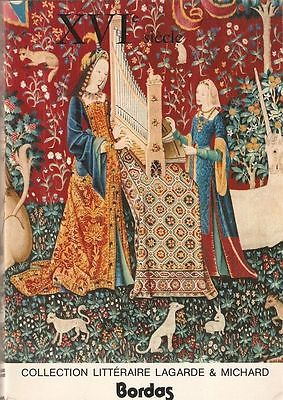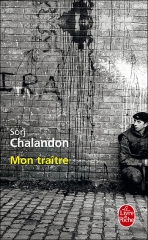La millième page des Essais tournée, je m’y arrête avant les trois cents qui restent de ce qu’il appelle son entreprise tantôt « épineuse », tantôt « sotte », « cet enfant-ci ». Les passages où Montaigne se décrit, au physique et au moral, je les garde pour une autre fois. C’est le fil conducteur de ces Essais où il veut donner à son portrait le mouvement de la vie. « Je ne peins pas l’être, je peins le passage, non un passage d’un âge à un autre, ou, comme dit le peuple, de sept en sept ans, mais de jour en jour, de minute en minute. »
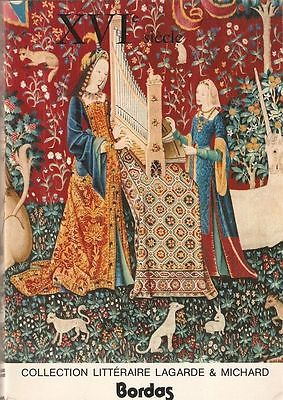
Mon premier contact avec Montaigne
« Quant à moi, j’estime que nos âmes se sont développées à vingt ans comme elles doivent le faire et qu’elles promettent tout ce dont elles sont capables. Jamais une âme qui n’a pas donné à cet âge des arrhes bien évidentes de sa force n’en a donné, depuis, la preuve. » (Livre I, « Sur l’âge ») Jamais ? Voilà qui me rappelle Milton : « La jeunesse montre l’homme comme le matin montre le jour. »
Montaigne reconnaît la complexité des êtres, l’inconstance de nos actions : « Nous sommes entièrement [faits] de lopins, et d’une contexture si informe et diverse que chaque pièce, chaque moment joue son jeu. Et il y a autant de différences de nous à nous-mêmes que de nous à autrui. « Magnam rem puta unum hominem agere. » [Sois persuadé qu’il est très difficile d’être toujours un seul et même homme] ajoute-t-il en citant Sénèque.
Au sujet des femmes, ses jugements me heurtent. Elles sont « toujours naturellement portées à être en désaccord avec leurs maris », « elles s’aiment le mieux quand elles ont le plus de tort », c’est « la faiblesse ordinaire du sexe ». Le chapitre « Sur trois femmes valeureuses » – « Il n’en existe pas par douzaines, comme chacun sait (…) » – rend hommage à trois épouses qui se sacrifient pour accompagner leurs maris dans la mort.
Dans « Sur trois sortes de relations sociales », Montaigne conseille aux femmes de se contenter de faire valoir « leurs richesses naturelles » : « C’est qu’elles ne se connaissent pas assez : le monde n’a rien de plus beau ; c’est à elles qu’il appartient d’honorer les arts et d’embellir ce qui est beau. Que leur faut-il [d’autre] que vivre aimées et honorées ? Elles n’ont et ne savent que trop pour cela. (…) Si toutefois elles sont ennuyées de nous le céder en quoi que ce soit et si elles veulent par curiosité avoir accès aux livres, la poésie est une occupation qui convient bien à leur besoin : c’est un art léger et subtil, paré, tout en paroles, tout en plaisir, tout en parade, comme elles. » Sans commentaire.
« Sur des vers de Virgile », où il est question de la sexualité et du mariage, contient cet aveu qui tempère de tels préjugés : « Nous sommes presque en tout, des juges iniques des femmes, comme elles le sont des nôtres. » Et enfin, « Je dis que les mâles et les femelles sont jetés dans un même moule : à part l’éducation et la coutume, la différence entre eux n’est pas bien grande. »
A propos d’éducation, justement, Montaigne estime que « seules l’humilité et la soumission peuvent façonner un homme de bien. Il ne faut pas laisser au jugement de chacun le soin de connaître où est son devoir ; il faut le lui prescrire, et non laisser à sa fantaisie [le droit] de le choisir : autrement, selon la faiblesse et la variété infinie de nos raisons et de nos opinions, nous nous forgerions finalement des devoirs qui nous conduiraient à nous manger les uns les autres, comme dit Epicure. »
« Sur les livres » éclaire le rôle de la lecture pour Montaigne. Il rappelle que ce qu’il écrit, ce sont ses idées personnelles, et non des connaissances à transmettre, tâche qu’il laisse aux savants. Aussi avance-t-il au hasard : « Je veux qu’on voie mon pas naturel et ordinaire, irrégulier comme il est. » – « Je ne cherche dans les livres que le moyen de me donner du plaisir pour une honnête distraction, ou, si j’étudie, je n’y cherche que la science qui traite de la connaissance de moi-même – et une science qui m’apprenne à bien mourir et à bien vivre. »
La mort, « remède à tous les maux », Montaigne en parle assez souvent. « La mort la plus volontaire, c’est la plus belle. La vie dépend de la volonté d’autrui ; la mort, de la nôtre. » (Une coutume de l’île de Zéa) Mais tous les sujets de la vie courante l’inspirent : l’ivrognerie, la fainéantise, la conscience, la cruauté, la gloire, le courage, la colère, la médecine (il se fie plus à la nature qu’aux médecins)…
Les expressions imagées de Montaigne sont le sel de la lecture (sans doute bien davantage dans le texte original, André Lanly les signale en bas de page quand il n’a pu les laisser). En voici deux exemples : « Je n’ai nullement étudié pour faire un livre, mais j’ai quelque peu étudié parce que je l’avais fait, si c’est étudier que d’effleurer et pincer par la tête ou par les pieds tantôt un auteur, tantôt un autre, nullement pour former mes opinions, mais bien pour les assister, formées [qu’elles sont] depuis longtemps, pour les seconder et les servir. »
« Surtout, c’est bien faire le sot, à mon gré, que de faire [l’homme] entendu parmi ceux qui ne le sont pas, de parler toujours tendu, favellar un punta di forchetta [parler sur la pointe d’une fourchette]. »